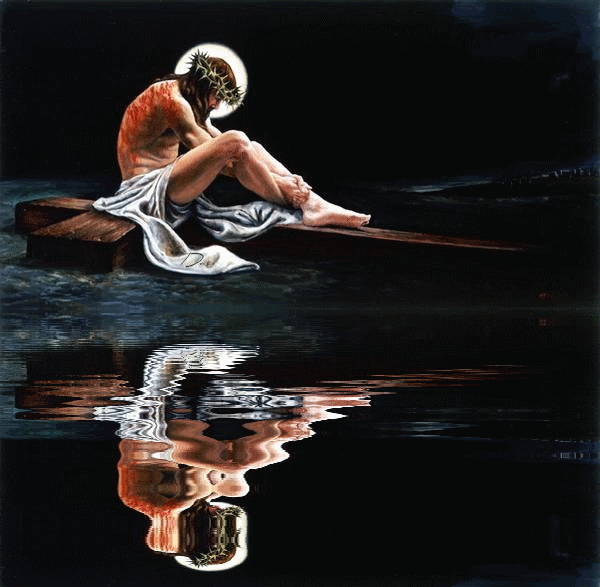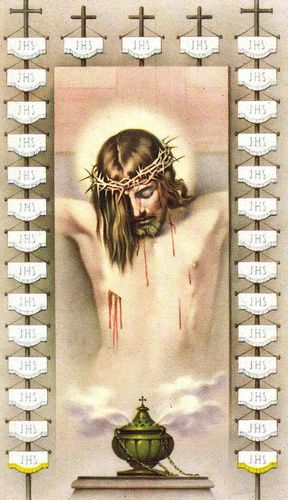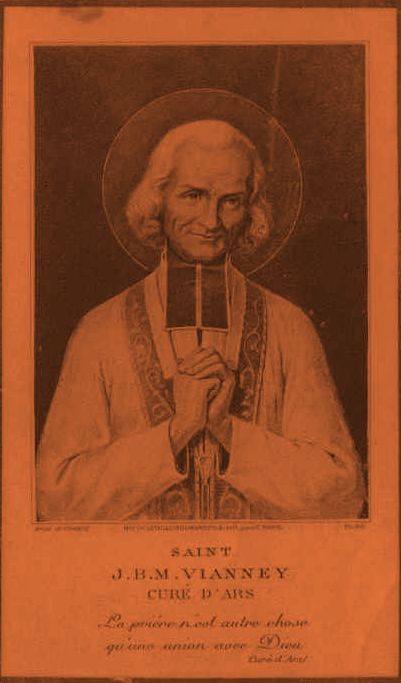Sainte-Jeanne d'Arc
Sainte-Jeanne d'ArcLIVRE DIX-NEUVIÈME : LE SOUVERAIN BIEN.
LIVRE DIX-NEUVIÈME : LE SOUVERAIN BIEN.
CHAPITRE PREMIER.
IL PEUT Y AVOIR, SELON VARRON, DEUX CENT QUATRE-VINGT-HUIT SYSTÈMES PHILOSOPHIQUES TOUCHANT LE SOUVERAIN BIEN.
CHAPITRE II.
COMMENT VARRON RÉDUIT TOUTES CES SECTES A TROIS, PARMI LESQUELLES IL FAUT CHOISIR LA BONNE.
CHAPITRE III.
QUEL EST, ENTRE LES TROIS SYSTÈMES SUR LE SOUVERAIN BIEN, CELUI QU'IL FAUT PRÉFÉRER, SELON VARRON, QUI SE DÉCLARE DISCIPLE D'ANTIOCHUS ET DE L'ANCIENNE ACADÉMIE.
CHAPITRE IV.
CE QUE PENSENT LES CHRÉTIENS SUR LE SOUVERAIN BIEN, CONTRE LES PHILOSOPHES QUI ONT CRU LE TROUVER EN EUX-MÊMES.
CHAPITRE V.
DE LA VIE SOCIALE ET DES MAUX QUI LA TRAVERSENT, TOUTE DÉSIRABLE QU'ELLE SOIT EN ELLE-MÊME.
CHAPITRE VI.
DE L'ERREUR DES JUGEMENTS HUMAINS, QUAND LA VÉRITÉ EST CACHÉE.
CHAPITRE VII.
DE LA DIVERSITÉ DES LANGUES QUI ROMPT LA SOCIÉTÉ DES HOMMES, ET DE LA MISÈRE DES GUERRES, MÊME LES PLUS JUSTES.
CHAPITRE VIII.
IL NE PEUT Y AVOIR PLEINE SÉCURITÉ, MÊME DANS L'AMITIÉ DES HONNÊTES GENS, A CAUSE DES DANGERS DONT LA VIE HUMAINE EST TOUJOURS MENACÉE.
CHAPITRE IX.
NOUS NE POUVONS ÊTRE ASSURÉS EN CETTE VIE DE L'AMITIÉ DES SAINTS ANGES, A CAUSE DE LA FOURBERIE DES DÉMONS, QUI ONT SU PRENDRE DANS LEURS PIÈGES LES ADORATEURS DES FAUX DIEUX.
CHAPITRE X.
QUELLE RÉCOMPENSE EST PRÉPARÉE AUI SAINTS QUI ONT SURMONTÉ LES TENTATIONS DE CETTE VIE.
CHAPITRE XI.
DU BONHEUR DE LA PAIX ÉTERNELLE, FIN SUPRÊME ET VÉRITABLE PERFECTION DES SAINTS.
CHAPITRE XII.
QUE LES AGITATIONS DES HOMMES ET LA GUERRE ELLE-MÊME TENDENT A LA PAIX, TERME NÉCESSAIRE OU ASPIRENT TOUS LES ÊTRES.
CHAPITRE XIII.
LA PAIX UNIVERSELLE, FONDÉE SUR LES LOIS DE LA NATURE, NE PEUT ÊTRE DÉTRUITE PAR LES PLUS VIOLENTES PASSIONS, LE JUGE ÉQUITABLE ET SOUVERAIN FAISANT PARVENIR CHACUN A LA CONDITION QU'IL A MÉRITÉE.
CHAPITRE XIV.
DE L'ORDRE A LA FOIS DIVIN ET TERRESTRE QUI FAIT QUE LES MAÎTRES DE LA SOCIÉTÉ HUMAINE EN SONT AUSSI LES SERVITEURS.
CHAPITRE XV.
LA PREMIÈRE CAUSE DE LA SERVITUDE, C'EST LE PÉCHÉ, ET L'HOMME , NATURELLEMENT LIBRE, DEVIENT, PAR SA MAUVAISE VOLONTÉ, ESCLAVE DE SES PASSIONS, ALORS MÊME QU'IL N'EST PAS DANS L'ESCLAVAGE D'AUTRUI.
CHAPITRE XVI.
DE LA JUSTE DAMNATION.
CHAPITRE XVII.
D'OU VIENNENT LA PAIX ET LA DISCORDE ENTRE LA CITÉ DU CIEL ET CELLE DE LA TERRE.
CHAPITRE XVIII.
COMBIEN LA FOI INÉBRANLABLE DU CHRÉTIEN DIFPÈRE DES INCERTITUDES DE LA NOUVELLE ACADÉMIE.
CHAPITRE XIX.
DE LA VIE ET DES MOEURS DU PEUPLE CHRÉTIEN.
CHAPITRE XX.
LES MEMBRES DE LA CITÉ DE DIEU NE SONT HEUREUX ICI-BAS QU'EN ESPÉRANCE.
CHAPITRE XXI.
D'APRÈS LES DÉFIN1TIONS ADMISES DANS LA « RÉPUBLIQUE » DE CICÉRON, IL N'Y A JAMAIS EU DE RÉPUBLIQUE PARMI LES ROMAINS.
CHAPITRE XXII.
LE DIEU DES CHRÉTIENS EST LE VRAI DIEU ET LE SEUL A QUI L'ON DOIVE SACRIFIER.
CHAPITRE XXIII.
DES ORACLES QUE PORPHYRE RAPPORTE TOUCHANT JÉSUS-CHRIST.
CHAPITRE XXIV.
SUIVANT QUELLE DÉFINITION L'EMPIRE ROMAIN, AINSI QUE LES AUTRES ÉTATS, PEUVENT S'ATTRIBUER JUSTEMENT LES NOMS DE PEUPLE ET DE RÉPUBLIQUE.
CHAPITRE XXV.
IL N'Y A POINT DE VRAIES VERTUS OU IL N'Y A POINT DE VRAIE RELIGION.
CHAPITRE XXVI.
LE PEUPLE DE DIEU, EN SON PÈLERINAGE ICI-BAS, FAIT SERVIR LA PAIX DU PEUPLE SÉPARÉ DE DIEU AUX INTÉRÊTS DE LA PIÉTÉ.
CHAPITRE XXVII.
LA PAIX DES SERVITEURS DE DIEU NE SAURAIT ÊTRE PARFAITE EN CETTE VIE MORTELLE.
CHAPITRE XXVIII.
DE LA FIN DES MÉCHANTS.
CHAPITRE PREMIER.
IL PEUT Y AVOIR, SELON VARRON, DEUX CENT QUATRE-VINGT-HUIT SYSTÈMES PHILOSOPHIQUES TOUCHANT LE SOUVERAIN BIEN.
Puisqu'il me reste à traiter de la fin de chacune des deux cités, je dois d'abord rapporter en peu de mots les raisonnements où s'égarent les hommes pour aboutir à se faire une béatitude parmi les misères de cette vie ; je dois en même temps faire voir, non-seulement par l'autorité divine, mais encore par la raison, combien il y a de différence entre les chimères des philosophes et l'espérance que Dieu nous donne ici-bas et qui doit être suivie de la véritable félicité. Les philosophes ont agité fort diversement la question de la fin des biens et des maux 1, et se sont donné beaucoup de peine pour trouver ce qui peut rendre l'homme heureux. Car la fin suprême, quant à notre bien, c'est l'objet pour lequel on doit rechercher tout le reste et qui ne doit être recherché que pour lui-même; et quant à notre mal, c'est aussi l'objet pour lequel il faut éviter tout le reste et qui ne doit être évité que pour lui-même. Ainsi, par la fin du bien, nous n'entendons pas une fin où il s'épuise jusqu'à n'être plus, mais où il s'achève pour atteindre à sa plénitude, et pareillement par la fin du mal , nous ne voulons pas parler de ce qui détruit le mal , mais de ce qui le porte à son comble. Ces deux fins sont donc le souverain bien et le souverain mal, et c'est pour les trouver que se sont beaucoup tourmentés, comme je le disais, ceux qui, parmi les vanités du siècle, ont fait profession d'aimer la sagesse. Mais, quoiqu'ils aient erré en plus d'une façon, la lumière naturelle ne leur a pas permis de
1. Ici, comme dans tout le cours du livre XIX, il est clair que saint Augustin se souvient du traité bien connu de Cicéron qui porte pour titre : De finibus bonorum et malorum, c'est-à-dire De la lin dernière où tendent les biens et les maux.
s'éloigner tellement de la vérité qu'ils n'aient mis le souverain bien et le souverain mal, les uns dans l'âme, les autres dans le corps, et les autres dans tous les deux. De cette triple division, Varron, dans son livre De la Philosophie 1, tire une si grande diversité de sentiments, qu'en y ajoutant quelques légères différences , il compte jusqu'à deux cent quatre-vingt-huit sectes, sinon réelles, du moins possibles.
Voici comment il procède : « Il y a, dit-il, quatre choses que les hommes recherchent naturellement, sans avoir besoin de maître ni d'art, et qui sont par conséquent antérieures à la vertu (laquelle est très-certainement un fruit de la science 2): premièrement, la volupté, qui est un mouvement agréable des sens; en second lieu, le repos, qui exclut tout ce qui pourrait incommoder le corps; en troisième lieu, ces deux choses réunies, qu'Epicure a même confondues sous le nom de volupté 3; enfin, les premiers biens de la nature, qui comprennent tout ce que nous venons de dire et d'autres choses encore, comme la santé et l'intégrité des organes, voilà pour le corps, et les dons variés de l'esprit, voilà pour l'âme. Or, ces quatre choses, volupté, repos, repos et volupté, premiers biens de la nature, sont en nous de telle sorte qu'il faut de trois choses l'une: ou rechercher la vertu pour elles, ou les rechercher pour la vertu, ou ne les rechercher que pour elles-mêmes; et de là naissent douze sectes. A ce compte, en effet, chacune est triplée, comme je vais le faire voir pour une d'elles, après quoi il ne sera pas difficile de s'en assurer pour les autres. Que la volupté
1. Ouvrage perdu.
2. Sur la question, tant controversée par les anciens, si la verts peut, ou non, être enseignée, voyez Platon (dans le Protagoras et le Ménon) et Plutarque en son traité : Que la vertu est chose qui s'enseigne.
3. Le mot d'Epicure est edone.
(425)
du corps soit soumise, préférée ou associée à la vertu, cela fait trois sectes. Or, elle est soumise à la vertu, quand on la prend pour instrument de la vertu. Ainsi, il est du devoir de la vertu de vivre pour la patrie et de lui engendrer des enfants, deux choses quine peuvent se faire sans volupté. Mais quand on préfère la volupté à la vertu, on ne recherche plus la volupté que pour elle-même; et alors la vertu n'est plus qu'un moyen pour acquérir ou pour conserver la volupté, et cette vertu esclave ne mérite plus son nom. Ce système infâme a pourtant trouvé des défenseurs et des apologistes parmi les philosophes. Enfin, la volupté est associée à la vertu, quand on ne les recherche point l'une pour l'autre, mais chacune pour elle-même. Maintenant, de même que la volupté, tour à tour soumise, préférée ou associée à la vertu, a fait trois sectes, de même le repos, la volupté avec le repos, et les premiers biens de la nature, en font aussi un égal nombre, sui vaut qu'elles sont soumises, préférées ou associées à la vertu, et ainsi voilà douze sectes. Mais ce nombre devient double en y ajoutant une différence, qui est la vie sociale. En effet, quiconque embrasse quelqu'une de ces sectes, ou le fait seulement pour soi, ou le fait aussi pour un autre qu'il s'associe et à qui il doit souhaiter le même avantage. Il y aura donc douze sectes de philosophes qui ne professeront leur doctrine que pour eux-mêmes, et douze qui l'étendront à leurs semblables, dont le bien ne les touchera pas e moins que leur bien propre. Or, ces vingt-quatre sectes se doublent encore et montent jusqu'à quarante-huit, en y ajoutant une différence prise des opinions de la nouvelle Académie 1. De ces vingt-quatre opinions, en effet, chacune peut être soutenue comme certaine, et c'est ainsi que les Stoïciens ont prétendu qu'il est certain que le souverain bien de l'homme ne consiste que dans la vertu, ou comme incertaine et seulement vraisemblable, comme ont fait les nouveaux académiciens. Voilà donc vingt-quatre sectes de philosophes qui défendent leur opinion comme assurée, et vingt-quatre autres qui la soutiennent comme douteuse. Bien plus, comme chacune de ces quarante-huit sectes peut être embrassée, ou en suivant la manière de vivre des autres philosophes, ou en
1. Sur la nouvelle Académie, voyez ci-après.
suivant celle des cyniques, cette différence les double encore et en fait quatre-vingt-seize. Ajoutez enfin à cela que, comme on peut embrasser chacune d'elles, ou en menant une vie tranquille, à l'exemple de ceux qui, par goût ou par nécessité, ont donné tous leurs moments à l'étude, ou bien une vie active, à la manière de ceux qui ont joint l'étude de la philosophie au gouvernement de l'Etat, ou une vie mêlée des deux autres, tels que ceux qui ont donné une partie de leur loisir à la contemplation et l'autre à l'action, ces différences peuvent tripler le nombre des sectes et en faire jusqu'à deux cent quatre-vingt-huit ».
Voilà ce que j'ai recueilli du livre de Varron le plus succinctement et le plus clairement qu'il m'a été possible, en m'attachant à sa pensée sans citer ses expressions. Or , de dire maintenant comment cet auteur, après avoir réfuté les autres sectes, en choisit une qu'il prétend être celle des anciens académiciens, et comment il distingue cette école, suivant lui dogmatique, dont Platon est le chef et Polémon le quatrième et dernier représentant, d'avec celle des nouveaux académiciens qui révoquent tout en doute, et qui commencent à Arcésilas, successeur de Polémon 1 ; de rapporter, dis-je, tout cela en détail, aussi bien que les preuves qu'il allègue pour montrer que les anciens académiciens ont été exempts d'erreur comme de doute, c'est ce qui serait infiniment long, et cependant il est nécessaire d'en dire un mot. Varron rejette donc dès l'abord toutes les différences qui ont si fort multiplié ces sectes , et il les rejette parce qu'elles ne se rapportent pas au souverain bien. Suivant lui, en effet, une secte philosophique n'existe et ne se distingue des autres, qu'à condition d'avoir une opinion propre sur le souverain bien. Car l'homme n'a d'autre objet en philosophant que d'être heureux; or, ce qui rend heureux, c'est le souverain bien , et par conséquent toute secte qui n'a pas pour aller au souverain
1. L'école académique, qui tire son nom d'un gymnase situé aux jardins d'Académus, près duquel habitait Platon, embrasse une période de quatre siècles, depuis Platon jusqu'à Antiochus. Les uns admettent trois académies : l'ancienne, celle de Platon, la moyenne, celle d'Arcésilas, la nouvelle, celle de Carnéade. Les autres en admettent quatre, savoir, avec les trois précédentes, celle de Philon. D'autres enfin ajoutent une cinquième académie, celle d'Antiochus, maître de Varron, de Lucullus et de Cicéron. - Parmi ces distinctions, une seule est importante, celle qui sépare Platon et ses vrais disciples, Speusippe et Xénocrate, de cette famille de faux platoniciens, de demi-sceptiques dont Arcésilas est le père et A.ntiochus le dernier membre considérable.
(425)
bien sa propre voie n'est pas vraiment une secte philosophique. Ainsi, quand on demande si le sage doit mener une vie civile et sociale et procurer à son ami tout le bien qu'il se procure à lui-même, ou s'il ne doit rechercher la béatitude que pour soi, il est question, non pas du souverain bien, mais de savoir s'il y faut associer quelque autre avec soi. De même, quand on demande s'il faut révoquer toutes choses en doute comme les nouveaux académiciens, ou si l'on doit les tenir pour certaines avec les autres philosophes, on ne demande pas quel est le bien qu'on doit rechercher, mais s'il faut douter ou non de la vérité du bien que l'on recherche. La manière de vivre des cyniques, différente de celle des autres philosophes, ne concerne pas non plus la question du souverain bien; mais, la supposant résolue, on demande seulement s'il faut vivre comme les cyniques. Or, il s'est trouvé des hommes qui, tout en plaçant le souverain bien en différents objets, les uns dans la vertu et les autres dans la volupté, n'ont pas laissé de mener le genre de vie qui a valu aux cyniques leur nom 1. Ainsi, ce qui fait la différence entre les cyniques et les autres philosophes est étranger à la question de la nature du souverain bien. Autrement, la même manière de vivre impliquerait la même fin poursuivie, et réciproquement, ce qui n'a pas lieu.
CHAPITRE II.
COMMENT VARRON RÉDUIT TOUTES CES SECTES A TROIS, PARMI LESQUELLES IL FAUT CHOISIR LA BONNE.
De même, lorsqu'on demande si l'on doit embrasser la vie active ou la vie contemplative, ou celle qui est mêlée des deux, il ne s'agit pas du souverain bien, mais du genre de vie le plus propre à l'acquérir ou à le conserver. Du moment, en effet, que l'homme est supposé parvenu au souverain bien, il est heureux ; au lieu que la paix de l'étude, ou l'agitation des affaires publiques, ou le mélange de cette agitation et de cette paix, ne donnent pas immédiatement le bonheur. Car plusieurs peuvent adopter l'un de ces trois genres de vie et se tromper sur la nature du souverain bien. Ce sont donc des questions
1. Allusion à certains Epicuriens et même à certains Stoïciens qui se rapprochaient beaucoup des cyniques dans leur manière de vivre.
entièrement différentes que celle du souverain bien, qui constitue chaque secte de philosophes, et celles de la vie civile, de l'incertitude des académiciens, du genre de vie et du vêtement des cyniques, enfin des trois sortes de vie, l'active, la contemplative et le mélange de l'une et de l'autre. C'est pourquoi Varron, rejetant ces quatre différences qui faisaient monter les sectes presque au nombre de deux cent quatre-vingt-huit, revient aux douze, où il s'agit uniquement de savoir quel est le souverain bien de l'homme, afin d'établir qu'une seule, parmi elles, contient la vérité, tout le reste étant dans l'erreur. Ecartez en effet les trois genres de vie, les deux tiers du nombre total sont retranchés, et il reste quatre-vingt-seize sectes. Otez la différence qui se tire des cyniques, elles se réduisent à la moitié, à quarante-huit. Otez encore la différence relative à la nouvelle Académie, elles diminuent encore de moitié, et tombent à vingt-quatre. Otez enfin la différence de la vie solitaire ou sociale, il ne restera plus que douze sectes, nombre que cette différence doublait et portait à vingt-quatre. Quant à ces douze sectes, on ne peut leur contester leur qualité, puisqu'elles ne se proposent d'autre recherche que celle du souverain bien. Or, pour former ces douze sectes, il faut tripler quatre choses : la volupté, le repos, le repos et la volupté, et les premiers biens de la nature, attendu que chacune d'elles est soumise, préférée ou associée à la vertu, ce qui donne bien douze pour nombre total. Maintenant, de ces quatre choses, Varron en ôte trois, la volupté, le repos, le repos joint à la volupté, non qu'il les improuve, mais parce qu'elles sont comprises dans les premiers biens de la nature. De sorte qu'il n'y a plus que trois sectes à examiner; car ici, comme en toute autre matière, il ne peut y en avoir plus d'une qui soit véritable, et ces trois sectes consistent en ce que l'on y recherche soit les premiers biens de la nature pour la vertu, soit la vertu pour les premiers biens de la nature, soit chacune de ces deux choses pour elle-même.
(426)
CHAPITRE III.
QUEL EST, ENTRE LES TROIS SYSTÈMES SUR LE SOUVERAIN BIEN, CELUI QU'IL FAUT PRÉFÉRER, SELON VARRON, QUI SE DÉCLARE DISCIPLE D'ANTIOCHUS ET DE L'ANCIENNE ACADÉMIE.
Voici comment Varron procède : il considère que le souverain bien que cherche la philosophie n'est pas le bien de la plante, ni de la bête, ni de Dieu, mais de l'homme; d'où il conclut qu'il faut savoir d'abord ce que c'est que l'homme. Or, il croit qu'il y a deux parties dans la nature humaine : le corps et l'âme, et ne doute point que l'âme ne soit beaucoup plus excellente que le corps. Mais de savoir si l'âme seule est l'homme, en sorte que le corps soit pour elle ce que le cheval est au cavalier, c'est ce qu'il prétend qu'on doit examiner : le cavalier, en effet, n'est pas tout ensemble l'homme et le cheval, mais l'homme seul, qui pourtant s'appelle cavalier, à cause de son rapport au cheval. D'un autre côté, le corps seul est-il l'homme, avec quelque rapport à l'âme, comme la cou peau breuvage? car ce n'est pas le vase et le breuvage tout ensemble, mais le vase seul qu'on appelle coupe, à condition toutefois qu'il soit fait de manière à contenir le breuvage. Enfin, si l'homme n'est ni l'âme seule, ni le corps seul, est-il un composé des deux, comme un attelage de deux chevaux n'est aucun des deux en particulier, mais tous les deux ensemble? Varron s'arrête à ce parti, ce qui l'amène à conclure que le souverain bien de l'homme consiste dans la réunion des biens de l'âme et de ceux du corps. Il croit donc que ces premiers biens de la nature sont désirables pour eux-mêmes, ainsi que la vertu, cet art de vivre qu'enseigne la science et qui est, parmi les biens de l'âme, le bien le plus excellent. Lors donc que la vertu a reçu de la nature ces premiers biens, qui sont antérieurs à toute science, elle les recherche pour soi, en même temps qu'elle se recherche soi-même, et elle en use comme elle use de soi, de manière à y trouver ses délices et sa joie, se servant de tous, mais plus ou moins, selon qu'ils sont plus ou moins grands, et sachant mépriser les moindres, quand cela est nécessaire pour acquérir ou pour conserver les autres. Or, de tous ces biens de l'âme et du corps II n'en est aucun que la vertu se préfère, parce qu'elle sait user comme il faut et de soi et de tout ce qui rend l'homme heureux; au contraire, où elle n'est pas, les autres biens, en quelque abondance qu'ils se trouvent, ne sont pas pour le bien de celui qui les possède, parce qu'il en use niai. La vie de l'homme est donc heureuse, quand il jouit et de la vertu et, parmi les autres biens de l'âme et du corps, de tous ceux sans lesquels la vertu ne peut subsister. Elle est encore plus heureuse, quand il possède d'autres biens dont la vertu n'a pas absolument besoin; enfin, elle est très-heureuse, lorsqu'il ne lui manque aucun bien, soit de l'âme, soit du corps. La vie, en effet, n'est pas la même chose que la vertu, puisque toute sorte de vie n'est pas vertu, mais celle-là seulement qui est sage et réglée : et cependant une vie, quelle qu'elle soit, peut être sans' la vertu, au lieu que la vertu ne peut être sans la vie. On peut en dire autant de la mémoire et de la raison : elles sont en l'homme avant la science, et la science ne saurait être sans elles, ni par conséquent la vertu, puisqu'elle est un fruit de la science. Quant aux avantages du corps, comme la vitesse, la beauté, la force, et autres semblables, bien que la vertu puisse être sans eux, comme eux sans elle, toutefois ce sont des biens; et selon ces philosophes, la vertu les aime pour l'amour d'elle-même, et s'en sert ou en jouit avec bienséance.
Ils disent que cette vie bienheureuse est aussi une vie sociale, qui aime le bien de ses amis comme le sien propre et leur souhaite les mêmes avantages qu'à elle-même soit qu'ils vivent dans la même maison, comme une femme, des enfants, des domestiques, ou dans la même ville, comme des citoyens, ou dans le monde, ce qui comprend le ciel et la terre, comme les dieux dont ils font les amis du sage et que nous sommes accoutumés à appeler les anges. En outre, ils soutiennent que sur la question du souverain bien et du souverain mal, il n'y a lieu à aucun doute, par où ils prétendent se séparer des nouveaux académiciens. Car peu leur importe, d'ailleurs, quelle sorte de vie on choisira pour atteindre le souverain bien, soit celle des cyniques, soit toute autre. Enfin, quant aux trois genres de vie dont nous avons parlé, la vie active, la vie contemplative et le mélange des deux, c'est celle-ci qui leur plaît davantage. Voilà donc la doctrine de l'ancienne Académie, telle que (427) Varron la reçut d'Antiochus 1, qui fut aussi le maître de Cicéron, quoique celui-ci le rattache plutôt à l'école stoïcienne qu'à l'Académie; mais cela nous importe peu, puisque nous cherchons moins à distinguer les diverses opinions des hommes qu'à découvrir la vérité sur le fond des choses.
CHAPITRE IV.
CE QUE PENSENT LES CHRÉTIENS SUR LE SOUVERAIN BIEN, CONTRE LES PHILOSOPHES QUI ONT CRU LE TROUVER EN EUX-MÊMES.
Si l'on nous demande quel est le sentiment de la Cité de Dieu sur tous ces points, et d'abord touchant la fin des biens et des maux, elle-même répondra que la vie éternelle est le souverain bien et la mort éternelle le souverain mal, et qu'ainsi nous devons tâcher de bien vivre, afin d'acquérir l'une et d'éviter l'autre. Il est écrit « Le juste vit de la foi 2 » En effet, en cette vie, nous ne voyons point encore notre bien, de sorte que nous le devons chercher par la foi, n'ayant pas en nous-mêmes le pouvoir de bien vivre, si celui qui nous a donné la foi dans son assistance ne nous aide à croire et à prier. Pour ceux qui ont cru que le souverain bien est en cette vie, qu'ils l'aient placé dans le corps ou dans l'âme, ou dans tous les deux ensemble, ou, pour résumer tous les systèmes, qu'ils l'aient fait consister dans la volupté, ou dans la vertu, ou dans l'une et l'autre; dans le repos, ou dans la vertu, ou dans l'un et l'autre; dans la volupté et le repos, ou dans la vertu, ou dans tout cela pris ensemble; enfin dans les premiers biens de la nature, ou dans la vertu, ou dans ces objets réunis, c'est en tous cas une étrange vanité d'avoir placé leur béatitude ici-bas, et surtout de l'avoir fait dépendre d'eux-mêmes. La Vérité se rit de cet orgueil, quand elle dit par un prophète : «Le Seigneur sait que les pensées des hommes sont vaines, ou comme parle l'apôtre saint Paul : « Le Seigneur connaît les pensées des sages et il sait qu'elles sont vaines 4 ».
Quel fleuve d'éloquence suffirait à dérouler
1. Nous avons dit plus, haut qu'Antiochus fut le chef d'une cinquième académie. Il était d'Ascalon et florissait au premier siècle avant Jésus-Christ. Son trait distinctif est d'avoir essayé une alliance entre les trois plus grandes écoles de l'antiquité : l'Académie, le Lycée et le Portique. Voyez sur Antiochus la récente monographie de M. Chapuis. Paris, 1854.
2. Habacuc, II, 4; Galat. III, 11. - 3. Ps. XCIII, 11. - 4. I Cor. III, 20.
toutes les misères de cette vie? Cicéron l'a essayé comme il a pu dans la Consolation sur la mort de sa fille I; mais que ce qu'il a pu est peu de chose! En effet, ces premiers biens de la nature, les peut-on posséder en cette vie qu'ils ne soient sujets à une infinité de révolutions? Y a-t-il quelque douleur et quelque inquiétude (deux affections diamétralement opposées à la volupté et au repos) auxquelles le corps du sage ne soit exposé? Le retranchement ou la débilité des membres est contraire à l'intégrité des parties du corps, la laideur à sa beauté, la maladie à sa santé, la lassitude à ses forces, la langueur ou la pesanteur à son agilité; et cependant, quel est celui de ces maux dont le sage soit exempt? L'équilibre du corps et ses mouvements, quand ils sont dans la juste mesure, comptent aussi parmi les premiers biens de la nature. Mais que sera-ce, si quelque indisposition fait trembler les membres? que sera-ce, si l'épine du dos se courbe, de sorte qu'un homme soit obligé de marcher à quatre pattes comme une bête? Cela ne détruira-t-il pas l'assiette ferme et droite du corps, la beauté et la mesure de ses mouvements? Que dirai-je des premiers biens naturels de l'âme, le sens et l'entendement, dont l'un lui est donné pour apercevoir la vérité, et l'autre pour la comprendre ? Où en sera le premier, si un homme devient sourd et aveugle ; et le second, s'il devient fou? Combien les frénétiques font-ils d'extravagances qui nous tirent les larmes des yeux, quand nous les considérons sérieusement? Parlerai-je de ceux qui sont possédés du démon? Où leur raison est-elle ensevelie, quand le malin esprit abuse de leur âme et de leur corps à son gré? Et qui peut s'assurer que cet accident n'arrivera point au sage pendant sa vie ? Il y a plus: combien défectueuse est la connaissance de la vérité ici-bas, où, selon les paroles de la Sagesse, « ce corps mortel et corruptible appesantit l'âme, et cette demeure de terre et de boue émousse l'esprit qui pense beaucoup 2 ». Cette activité instinctive (que les Grecs appellent orme) également comptée au nombre des premiers biens de la nature 3, n'est-elle pas dans les furieux
1. Cet ouvrage est perdu, sauf un petit nombre de courts fragments que Lactance noua a conservés. Le morceau qui se trouve dans les oeuvres de Cicéron sous le nom de Consolation est un pastiche industrieux de quelque cicéronien de la renaissance.
2. Sag. IX, 15.
3. Voyez Cicéron, De finibus, lib. V, cap, 6; De nat. Deor., lib. II, cap. 22.
(428)
la cause de ces mouvements et de ces actions qui nous font horreur?
Enfin, la vertu, qui n'est pas au nombre des biens de la nature, puisqu'elle est un fruit tardif de la science, mais qui toutefois réclame le premier rang parmi les biens de l'homme, que fait-elle sur terre, sinon une guerre continuelle contre les vices, je ne parle pas des vices qui sont hors de nous, mais de ceux qui sont en nous, lesquels ne nous sont pas étrangers, mais nous appartiennent en propre? Quelle guerre doit surtout soutenir cette vertu que les Grecs nomment sophrosune, et nous tempérance , quand il faut réprimer les appétits désordonnés de la chair, de peur qu'ils ne fassent consentir l'esprit à des actions criminelles? Et ne nous imaginons pas qu'il n'y ait point de vice en nous, lorsque « la chair, comme dit l'Apôtre, convoite contre l'esprit » ; puisqu'il existe une vertu directement contraire, celle que désigne ainsi le même Apôtre : « L'esprit convoite contre la chair » ; et il ajoute : « Ces principes sont contraires l'un à l'autre, et vous ne faites pas ce que vous voudriez 2 ». Or, que voulons-nous faire, quand nous voulons que le souverain bien s'accomplisse en nous, sinon que la chair s'accorde avec l'esprit et qu'il n'y ait plus entre eux de divorce? Mais , puisque nous ne le saurions faire en cette vie, quelque désir que nous en ayons, tâchons au moins, avec le secours de Dieu, de ne point consentir aux convoitises déréglées de la chair. Dieu nous garde donc de croire, déchirés que nous sommes par cette guerre intestine, que nous possédions déjà la béatitude qui doit être le fruit de notre victoire t Et qui donc est parvenu à ce comble de sagesse qu'il n'ait plus à lutter contre ses passions?
Que dirai-je de cette vertu qu'on appelle prudence? Toute sa vigilance n'est-elle pas occupée à discerner le bien d'avec le mal, pour rechercher l'un et fuir l'autre ? Or, cela ne prouve-t-il pas que nous sommes dans le mal et que le mal est en nous? Nous apprenons par elle que c'est un mal de consentir à nos mauvaises inclinations, et que c'est un bien d'y résister; et cependant ce mal, à qui la prudence nous apprend à ne pas consentir et
1. « Les Grecs, dit Cicéron, appellent sophrosune cette vertu que j'ai coutume de nommer tempérance ou modération, quelquefois aussi mesure (Tusculanes, livre III, ch. 8) ». Comparez Platon, République, livre IV.
2. Galat. V, 17.
que la tempérance nous fait combattre, ni la tempérance, ni la prudence ne le font disparaître. Et la justice, dont l'emploi est de rendre à chacun ce qui lui est dû 1 (par où se maintient en l'homme cet ordre équitable de la nature, que l'âme soit soumise à Dieu, le corps à l'âme, et ainsi l'âme et le corps à Dieu), ne fait-elle pas bien voir, par la peine qu'elle prend à s'acquitter de cette fonction, qu'elle n'est pas encore à la fin de son travail ? L'âme est en effet d'autant moins soumise à Dieu qu'elle pense moins à lui; et la chair est d'autant moins soumise à l'esprit qu'elle a plus de désirs qui lui sont contraires. Ainsi, tant que nous sommes sujets à ces faiblesses et à ces langueurs, comment osons-nous dire que nous sommes déjà sauvés? Et si nous ne sommes pas encore sauvés, de quel front pouvons-nous prétendre que nous sommes bienheureux? Quant à la force, quelque sagesse qui l'accompagne, n'est-elle pas un témoin irréprochable des maux qui accablent les hommes et que la patience est contrainte de supporter ? En vérité, je m'étonne que les Stoïciens aient la hardiesse de nier que ce soient des maux, en même temps qu'ils prescrivent au sage, si ces maux arrivent à un point qu'il ne puisse ou ne doive pas leS souffrir, de se donner la mort, de sortir de la vie 2. Cependant telle est la stupidité où l'orgueil fait tomber ces philosophes, qui veulent trouver en cette vie et en eux-mêmes le principe de leur félicité, qu'ils n'ont point de honte de dire que leur sage, celui dont ils tracent le fantastique idéal , est toujours heureux, devînt-il aveugle, sourd, muet, impotent, affligé des plus cruelles douleurs et de celles-là mêmes qui l'obligent à se donner la mort. O la vie heureuse, qui, pour cesser d'être, cherche le secours de la mort! Si elle est heureuse, que n'y demeure-t-on; et si on la fuit à cause des maux qui l'affligent comment est-elle bienheureuse? Se peut-il faire qu'on n'appelle point mal ce qui triomphe du courage même, ce qui ne l'oblige pas seulement à se rendre, mais le porte encore à ce délire de regarder comme heureuse une vie que l'on doit fuir? Qui est assez aveugle pour
1. C'est la définition consacrée par le droit romain : La justice est une volonté perpétuelle et constante de rendre à chacun ce qui lui est dû (Instit., tit. de Justitia et jure) ».
2. L'école stoïcienne permettait et même en certains cas commandait le suicide. Caton, Brutus et bien d'autres ont pratiqué jusqu'en bout ce qu'ils croyaient leur droit ou leur devoir.
(429)
ne pas voir que si on doit la fuir, c'est qu'elle n'est pas heureuse? et s'ils avouent qu'on la doit fuir à cause des faiblesses qui l'accablent, que ne quittent-ils leur superbe, pour avouer aussi qu'elle est misérable ? N'est-ce pas plutôt par impatience que par courage que ce fameux Caton s'est donné la mort, et pour n'avoir pu souffrir César victorieux? Où est la force de cet homme tant vanté? Elle a cédé, elle a succombé, elle a été tellement surmontée qu'il a fui et abandonné une vie bienheureuse. Elle ne l'était plus , dites-vous? Avouez donc qu'elle était malheureuse. Et dès lors, comment ce qui rend une vie malheureuse et détestable ne serait-il pas un mal?
Aussi les Péripatéticiens et ces philosophes de la vieille Académie, dont Varron se porte le défenseur, ont-ils eu la sagacité de céder sur ce point; mais leur erreur est encore étrange de soutenir que malgré tous les maux, le sage ne laisse pas d'être heureux. « Les tortures et les douleurs du corps sont des maux, dit Varron, et elles le sont d'autant plus qu'elles prennent plus d'accroissement ; et voilà pourquoi il faut s'en délivrer en sortant de la vie ». De quelle vie, je vous prie? De celle, dit Varron, qui est accablée de tant de maux. Quoi donc! est-ce de cette vie toujours heureuse au milieu même des maux qui doivent nous en faire sortir? ou ne l'appelez- vous heureuse que parce qu'il vous est permis de vous en délivrer? Que serait-ce donc si quelque secret jugement de Dieu vous retenait parmi ces maux sans permettre à la mort de vous en affranchir jamais! Alors du moins seriez-vous obligés d'avouer qu'une vie de cette sorte est misérable. Ce n'est donc pas pour être promptement quittée qu'elle n'est pas misérable, à moins de vouloir appeler félicité une courte misère. Certes, il faut que des maux soient bien violents pour obliger un homme, et un homme sage, à cesser d'être homme pour s'en délivrer. Ils disent, en effet, et avec raison, que c'est le premier cri de la nature que l'homme s'aime soi-même, et partant qu'il ait une aversion instinctive pour la mort et cherche tout ce qui peut entretenir l'union du corps et de l'âme 1. Il faut donc que des maux soient bien violents pour
1. Ce sont presque les expressions de Cicéron dans le De finibus, lib. V, cap 5. Comp. Ibid., lib. V, cap. 9, et le De officies, lib. I, cap,4.
étouffer ce sentiment de la nature et l'éteindre à ce point que nous désirions la mort et tournions nos propres mains contre nous-mêmes, si personne ne consent à nous la donner. Encore une fois, il faut que des maux soient bien violents pour rendre la force homicide, si néanmoins la force mérite encore son nom, alors qu'elle succombe sous le mal et non-seulement ne peut conserver par la patience un homme dont elle avait pris le gouvernement et la protection, mais se voit réduite à le tuer. Oui, j'en conviens, le sage doit souffrir la mort avec patience , mais quand elle lui vient d'une main étrangère; si donc, suivant eux, il est obligé de se la donner, il faut qu'ils avouent que les accidents qui 1'y obligent ne sont pas seulement des maux, mais des maux insupportables. A coup sûr, une vie sujette à tant de misères n'eût jamais été appelée heureuse, si ceux qui lui donnent ce nom cédaient à la vérité comme ils cèdent à la douleur, au lieu de prétendre jouir du souverain bien dans un lieu où les vertus même, qui sont ce que l'homme a de meilleur ici-bas, sont des témoins d'autant plus fidèles de nos misères qu'elles travaillent davantage à nous en garantir. Si ce sont donc des vertus véritables, et il ne peut y en avoir de telles qu'en ceux qui ont une véritable piété, elles ne promettent à personne de le délivrer de toutes sortes de maux; non, elles ne font pas cette promesse, parce qu'elles ne savent pas mentir; tout ce qu'elles peuvent faire, c'est de nous assurer que si nous espérons dans le siècle à venir, cette vie humaine, nécessairement misérable à cause des innombrables épreuves du présent, deviendra un jour bienheureuse en gagnant du même coup le salut et la félicité. Mais comment posséderait-elle la félicité, quand elle ne possède pas encore le salut? Aussi l'apôtre saint Paul, parlant, non de ces philosophes véritablement dépourvus de sagesse, de patience, de tempérance et de justice, mais de ceux qui ont une véritable piété et par conséquent des vertus véritables, dit : « Nous sommes sauvés en espérance. Or, la vue de l'objet espéré n'est plus de l'espérance. Car qui espère ce qu'il voit déjà? Si donc nous espérons ce que nous ne voyons pas encore, c'est que nous l'attendons par la patience ». Il en est de notre bonheur comme de notre salut; nous ne le
1. Rom. VIII, 24, 25.
(430)
possédons qu'en espérance ; il n'est pas dans le présent, mais dans l'avenir, parce que nous sommes au milieu de maux qu'il faut supporter patiemment, jusqu'à ce que nous arrivions à la jouissance de ces biens ineffables qui ne seront traversés d'aucun déplaisir. Le salut de l'autre vie sera donc la béatitude finale, celle que nos philosophes refusent de croire, parce qu'ils ne la voient pas, substituant à sa place le fantôme d'une félicité terrestre fondée sur une trompeuse vertu, d'autant plus superbe qu'elle est plus fausse.
CHAPITRE V.
DE LA VIE SOCIALE ET DES MAUX QUI LA TRAVERSENT, TOUTE DÉSIRABLE QU'ELLE SOIT EN ELLE-MÊME.
Nous sommes beaucoup plus d'accord avec les philosophes, quand ils veulent que la vie du sage soit une vie de société. Comment la Cité de Dieu (objet de cet ouvrage dont nous écrivons présentement le dix-neuvième livre) aurait-elle pris naissance, comment se serait-elle développée dans le cours des temps, et comment parviendrait-elle à sa fin, si la vie des saints n'était une vie sociale? Mais dans notre misérable condition mortelle, qui dira tous les maux auxquels cette vie est sujette ? qui en pourra faire le compte ? Ecoutez leurs poëtes comiques : voici ce que dit un de leurs personnages avec l'approbation de tout l'auditoire:
« Je me suis marié, quelle misère! j'ai eu des enfants, surcroît de soucis ! »
Que dirai-je des peines de l'amour décrites par le même poëte : « Injures, soupçons, inimitiés, la guerre aujourd'hui, demain la paix 2 ! » Le monde n'est-il pas plein de ces désordres, qui troublent même les plus honnêtes liaisons? Et que voyons-nous partout, sinon les injures, les soupçons, les inimitiés et la guerre? Voilà des maux certains et sensibles; mais la paix est un bien incertain, parce que chez ceux avec qui nous la voudrions entretenir, le fond des cœurs nous reste inconnu, elle connaîtrions-nous aujourd'hui, qui sait s'il ne sera pas changé demain? En effet, où y a-t-il d'ordinaire et où devrait-il y avoir plus d'amitié que parmi les
1. Térence, Adelphes, acte V, scène 4.
2. Voyez l'Eunuque, acte I, scène 1.
habitants du même foyer ? Et toutefois, comment y trouver une pleine sécurité, quand on voit tous les jours des parents qui se trahissent l'un l'autre, et dont la haine longtemps dissimulée devient d'autant plus amère que la paix de leur liaison semblait avoir plus de douceur? C'est ce qui a fait dire à Cicéron cette parole qui va si droit au coeur qu'elle en tire un soupir involontaire: « Il n'y a point de trahisons plus dangereuses que celles qui se couvrent du masque de l'affection ou du nom de la parenté. Car il est aisé de se mettre en garde contre un ennemi déclaré; mais le moyen de rompre une trame secrète, intérieure, domestique, qui vous enchaîne avant que vous ayez pu la reconnaître ou la prévoir ! » De là vient aussi ce mot de l'Ecriture, qu'on ne peut entendre sans un déchirement de coeur : « Les ennemis de l'homme, ce sont les habitants de sa maison 1 ». Et quand on aurait assez de force pour supporter patiemment une trahison, assez de vigilance pour en détourner l'effet, il ne se peut faire néanmoins qu'un homme de bien ne s'afflige beaucoup (le trouver en ses ennemis une telle perversité, soit qu'ils l'aient dès longtemps dissimulée sous une bonté trompeuse, ou que, de bons qu'ils étaient, ils soient tombés dans cet abîme de corruption. Si donc le foyer domestique n'est pas un asile assuré contre tant de maux, que sera-ce d'une cité? Plus elle est grande, plus elle est remplie de discordes privées et de crimes, et, si elle échappe aux séditions sanglantes et aux guerres civiles, n'a-t-elle point toujours à les redouter?

/image%2F1256559%2F20200911%2Fob_150f46_espoir-salut-france-parousie-over-blog.gif)
/image%2F1256559%2F20220309%2Fob_24b9f3_mains-priant-drapeau-ukrainien-parousi.jpg)





/image%2F1256559%2F20200911%2Fob_a756cc_notre-dame-de-lourdes-gif-water-reflec.gif)